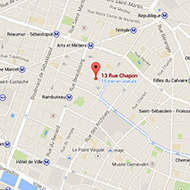Corps brisés
Guillaume Picon, 2014
Ici, sur un rectangle d'un rouge irrégulier, se détache une main, figure de proue quasi immobile d'un avant-bras abandonné. Entre ombre et lumière, de ses cinq doigts solitaires, elle apostrophe celui qui passe, l'incitant à entrer. Là, un buste éreinté est en proie à des mouvements contraires. À la fois de chair et d'airain, des épaules fragiles redoublent d'efforts pour ne pas s'affaisser, tandis qu'un visage assoupi se laisse glisser vers un néant de lumière. Plus loin, des jambes s'agitent, vaine tentative d'échapper à l'attraction des couleurs sans fond qui les enserrent? À quel voyage ces corps fragmentés de Martin Bruneau sont-ils l'invitation ?
En fait de voyage, il s'agit d'un périple, c'est-à-dire d'un de ces longs voyages en mer dans lesquels les explorateurs, de la fin du XVe au début du XXe siècle, s'embarquaient à leurs risques et périls. De l'aveu-même du peintre, cette nouvelle série trouve son origine dans le célèbre tableau de Géricault, le Radeau de la Méduse (1819). Il y a donc fort à parier que la traversée ne sera pas de tout repos. En 1816, la Méduse, un navire français, avait échoué sur un banc de sable, au large du Sénégal. Une partie des passagers était alors montée dans les chaloupes, les autres, par manque de place, avaient été obligés de se réfugier sur un radeau de fortune. La suite de l'histoire importe peu puisque le tableau de Géricault n'est, ici, que le point de départ à partir duquel Bruneau déploie son talent. Ainsi, le radeau construit par les naufragés de la Méduse est pour ainsi dire absent. Demeurent les corps dont Bruneau a conservé la position et les mouvements qui étaient les leurs sur le frêle esquif. Ils semblent flotter, entre ciel et mer, vie et mort, alarme et repos. Surtout, l'artiste s'est plu à les séparer, à les fragmenter, à les amputer. C'est sans doute la raison pour laquelle ils apparaissent comme brisés sur les récifs du radeau disparu.
Reliés les uns aux autres, les corps de Bruneau décrivent une danse macabre qui se déploie telle une métaphore de la peinture qui, entre figuration et abstraction, a encore et toujours quelque chose à dire. C'est là le tour de force du peintre d'être parvenu à composer une variation sur le corps, où les couleurs, implacables contrepoints, donnent le tempo, jusqu'à parfois laisser croire qu'elles mènent la danse. Sa palette peut donc laisser libre cours à la force de la couleur et se déployer pour dire non pas tant autre chose qu'autrement. Ainsi sublimée, la couleur de Bruneau ne saurait se réduire à un simple aplat ou à un fond sommaire. Elle s'ingénie à neutraliser, à tout le moins à contrarier, la dimension narrative de la toile. En somme Bruneau opère, là, un de ces renversements chers à Baselitz qui aimait à dire que « le renversement (...) du motif [lui] donnait la liberté de [s']attacher à des problèmes picturaux. » Non seulement Bruneau soulève des problèmes, mais il s'attache à les résoudre. Sous son pinceau, la juxtaposition de deux peintures - abstraite et figurative - ne jure pas. Au contraire elle s'équilibre au-delà des corps et de la couleur, selon des lois relevant de la (méta)physique de la peinture et menant à cette « pureté de la peinture » si chère au critique Clement Greenberg. La possibilité d'une représentation demeure, malgré tout - et non pas en vain. C'est sur cette voie que Bruneau a choisi de naviguer.
Guillaume Picon
Historien et commissaire d'exposition
---
Les illuminations de Martin Bruneau
Jean-Paul Gavard-Perret, Arts'Up, décembre 2010
En choisissant de peindre un repas entre amis, Martin Bruneau transforme un thème classique, un sujet inscrit dans le quotidien et à partir de photographies prises il y a quelques années. Toutefois le travail pictural ne se veut en rien réaliste et encore moins hyperréaliste. Il ne se veut pas non plus portrait de groupe ou commémoration d'une intimité perdue. Martin Bruneau (artiste canadien « exilé » à Autun) entraîne sur de fausses pistes en disant peindre ces repas « avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec les maladresses et incompétences qui sont les miennes et qui sont celles propres à toute représentation non mécanique. Le « réel » se situe peut-être dans ces maladresses et approximations ? ». De fait l'artiste, inconsciemment - si l'on en croît son affirmation - ou non, va beaucoup plus loin que les adeptes américains de la « Bad Painting ». Entre autres qu'Eric Fischl dont le tableau d'une femme tombant d'une des tours de 11 Septembre fut interdit d'exposition ou encore que Wayne Thiebaud dont l'artiste reste toutefois assez proche quant à ses thématiques. Mais celui-ci pose beaucoup plus la question de la peinture que celle du réalisme.
L'artiste parvient à créer des illuminations par son langage plus que par la charge symbolique ou métaphorique que contient malgré tout ses ?uvres dans lesquelles l'appauvrissement affectif de la société reste présent. Le sentiment de maladresse et de gêne que le peintre dit éprouver devient une expérimentation face à des évènements émotionnels aussi simples que profonds. Des images les plus simples par effet de couleurs, matières et traits surgit une atmosphère quasiment plus onirique que réaliste. L'imaginaire et la technique du peintre vont vers une concentration de l'émotion dans une sorte de recueillement. Plus que nourritures terrestres les aliments présents sur la toile deviennent de nature spirituelle. Les pigments, leur façonnage créent une présence quasi immatérielle : tout échappe au lisse et au silence. Quelque chose vibre par la matérialité de la peinture. Le thème n'est plus qu'un prétexte à une forme de prière particulière au rassemblement même si la peinture ne s'embourbe jamais dans la psychologisation par une présence humaine.
Le naturel et l'indépendance de la picturalité sont ici essentiels. Ils rompent et dérangent le ronronnement de l'art dans les bégaiements de sa déstructuration de façade. Bruneau a dépassé ce stade infantile. Depuis longtemps il est entré en un âge de raison. Il défend la peinture en la prenant pour ce qu'elle est en se battant avec. A ne pas faire comme tout le monde l'artiste prend le risque d'être reconnu par personne (ou trop peu) mais il s'en fiche. Il crée des masses aussi lourdes que gazeuses dans lesquelles sous l'apparent brouillage rien ne manque au niveau de l'essence de la peinture. Si le regard de Bruneau sait rencontrer des espaces intimes ses gestes savent les restituer avec une forme de concision et d'enchantement. Au pittoresque, à la variété l'artiste préfère la lenteur des approfondissements. Ils obligent à se frayer de nouveaux chemins au sein de la réalité la plus simple comme dans une forêt vierge.
Et là où certains pourraient croire à un conformisme se découvre une liberté qui détourne des étiquettes. Même la « Bad Painting » ne pourrait donc que réduire la force et l'individualisme de l'?uvre. Elle possède un point de vue non seulement sur la vie mais sur la peinture et s'y tient. Qu'importe les possibles malentendus : il faut se laisser prendre par les « maladresse » et « approximations » que Bruneau revendique car il est pressant de dessiller les yeux des bien pensants qui s'obstinent à voir en sa peinture une simple composante du réalisme. Le réel n'a d'intérêt en peinture que s'il est comme le peintre le propose : re-présenté en réinterprétant ou en jetant cul par-dessus tête un certain nombre de règles.
---
Le tumulte de la peinture
Laure Blanc Benon, Lyon, décembre 2010
Peindre ce que l'on voit n'a rien d'aisé. Même si à l'époque classique la hiérarchie des genres voulait qu'il soit plus facile de peindre ce que l'on voit (une nature morte) que ce que l'on ne voit pas (une scène mythologique). Que peint Martin Bruneau ? Peint-il des images ? Des portraits ? Des natures mortes ? Des toiles abstraites ? Sa peinture est travaillée depuis de nombreuses années déjà par cette question désarmante : que peindre aujourd'hui ? Représenter la réalité, avec comme seul moyen la composition picturale, tel est le problème de départ, problème sans âge.
Avec sa nouvelle série de Repas, Martin Bruneau atteint un état d'équilibre dans le monde de peinture qui est le sien. Premier temps : un dîner qui a eu lieu et des photographies prises au moyen d'un téléphone portable, de ces images platement illustratives ou narratives qui saturent notre quotidien. Deuxième temps : le travail silencieux de la peinture. Troisième temps : la série des Repas, série de toiles qui fait voir et même entendre la présence de la réalité au travers de corps et d'objets représentés. Il y a bien représentation mais au sens de la présence d'une Figure : ni natures mortes, ni portraits, ni toiles abstraites, et pourtant tout cela à la fois.
Formats. Le repas donne lieu à des toiles devant lesquelles on déambule, de grand format, mais également à des fragments, des détails qui sont traités comme des natures mortes sur de plus petits formats. La série fait donc référence à différentes traditions picturales. Mais le jeu sur les formats introduit un mouvement qui fait également songer au cinéma (plus qu'à la photographie dont est partie la série). Il permet comme un voyage immobile, à l'instar du spectateur de cinéma plongé dans le noir, immobile dans le fond de son siège et qui voit s'enchaîner plan général, plan rapproché, gros plan, sans parler des effets de mouvement comme le zoom par exemple. Dès lors qu'elle n'est ni purement figurative, ni purement abstraite, la peinture fait appel au mouvement du spectateur qui, par ses avancées et ses reculs, fait varier la distance à laquelle les marques ou taches deviennent des signes dans la composition. Les détails peints sur de petits formats sont autant de « visions de près » que le peintre nous livre comme pendant à ses « visions de loin » que sont les tablées. De même que Diderot s'avançait et se reculait face à une toile de Chardin, nous sommes invités à chercher la présence du réel dans les détails d'une feuille de salade que l'on scrute de près comme dans le sourire lointain d'un visage qui s'estompe sur le fond de la toile.
Cadrage. Martin Bruneau avait déjà coupé les têtes dans la série des Duchesse Goya ; il les avaient aussi déjà dé-figurées dans sa série de Têtes d'après Lucas Cranach : le contour restait net mais le visage était travaillé de manière abstraite, au moyen de touches bien visibles. Ici encore, dans ces représentations d'un repas, les têtes et les visages sont en partie hors du cadre, hors-champ pourrait-on dire. Il ne s'agit pas d'une vue d'ensemble, nous n'avons pas le recul nécessaire : nous sommes à table nous aussi, spectateur et convive à la fois. Nous sommes donc dans la peinture, que nous nous approchions ou que nous nous reculions ne change rien au fait que nous ne pouvons pas en sortir complètement, comme ce serait le cas pour la peinture illustrative ou narrative. La peinture ici nous impose sa présence et nous englobe. Les convives en face de nous, non seulement sortent en partie du cadre de la toile, mais se fondent également dans l'arrière-plan, de couleur vive (rose ou vert) ou bien d'un blanc ou d'un gris-bleu lumineux. Ils devraient ressortir sur ces fonds clairs mais les traits s'estompent car les visages sont travaillés de manière abstraite, si l'on entend par là que la touche reste visible et ne se transforme pas complètement en signe, en « trait du visage ». Parfois les touches se fondent entre elles et contribuent à aplanir la représentation comme lorsque des touches blanches figurant la fumée et la chaleur qui s'élèvent au-dessus des bougies se juxtaposent à des touches bleues pâles sur le pull d'un convive, sur sa main, sur son visage et sur l'arrière plan. Ces différentes touches appartiennent au même plan de peinture même si dans l'image elles sont censées être le signe de trois plans différents s'étageant en profondeur (la bougie, le convive, le fond). La prédominance du noir sur les vêtements et sur la table contribue également à rabattre sur le même plan de peinture ce qui figure dans la réalité sur deux plans orthogonaux l'un à l'autre, renforçant la dimension de négation de l'illusion figurative.
Quadrillage. La grille est également récurrente dans le travail pictural de Martin Bruneau. Elle aussi a pour effet de casser tout effet narratif ou illustratif de la représentation figurative. Dans l'histoire de la peinture, la grille est liée à la figuration par le biais d'Alberti et de la perspective mais également à l'abstraction en tant que forme géométrique que l'on songe à Mondrian ou à Vasarely, ou même à François Rouan pour qui la grille permet de peindre entre les dessus et les dessous de la peinture. Dans la seule toile de la série des Repas dans laquelle les bustes des convives apparaissent en entier, le recours au quadrillage permet d'obtenir un effet similaire à celui du cadrage qui coupe les têtes à mi-hauteur : au lieu de voir se succéder trois plans (la table, les bustes des convives et le fond) le quadrillage ramène tout sur le même plan, celui de la peinture en tant que matérialité. La toile n'est pas comme une fenêtre : notre regard ne passe pas au travers et le quadrillage permet de confondre en un seul plan le fond de l'image et le premier plan. Mais ce plan sur lequel tout est ramené n'est pas plat pour autant : il a une épaisseur qui apparaît au regard dès lors qu'on scrute les touches qui débordent par-dessus ou par-dessous l'emplacement des bandes de scotch. Ni abstraite, ni figurative, la peinture de Martin Bruneau explore la paradoxale épaisseur du plan. Lorsqu'elle s'attaque à la figure, elle a besoin de techniques appropriées pour éviter toute identification : lorsque les visages ne sont pas tronqués, leur traitement abstrait au moyen de larges touches est accentué et la ressemblance s'estompe. Dans les toiles qui sont des fragments de nature morte, le quadrillage produit également un effet d'abstraction qui vient équilibrer la dimension nécessairement figurative de toute nature morte. En peignant par dessus des bandes de scotch qui sont ensuite ôtées, Martin Bruneau introduit un interstice à même le plan de la toile et produit ainsi un effet de profondeur qui n'a rien à voir avec l'illusion qui consiste à passer au travers de la fenêtre de la peinture. Le regard perçoit bien une assiette jaune remplie de salade verte mais lorsqu'il cherche à se fixer, il oscille entre différents plans : les touches mêlées de vert et de blanc (mélange inachevé qui laisse le pigment pur apparaître) débordent d'un carré du quadrillage sur l'autre, rendant impossible l'identification du dessus et du dessous, du devant et du derrière. Quand les touches de vert débordent d'un carré sur l'autre, enjambant ainsi le quadrillage, elles font passer le quadrillage au second plan, mais quand la touche jaune signifiant le contour de l'assiette passe « par-dessus » les touches vertes, le quadrillage repasse au premier plan. Cet effet est renforcé par le traitement de la luminosité propre au noir : les carrés plus mats dans lesquels le noir se teinte de reflets rouges sont-ils au premier ou au second plan ? Il y a donc bien une épaisseur du plan de peinture qui déborde la planéité idéale de la surface peinte. Les objets représentés n'apparaissent pas au-delà de la toile, comme au travers d'une fenêtre, ils sont pris dans la toile, qui a une épaisseur. S'il l'on repense aux photographies numériques qui ont servi de point de départ au travail du peintre, un gouffre est franchi : nous sommes passés d'une image platement illustrative à la profondeur du plan de peinture. Quand la photographie du repas invite seulement notre regard à traverser le plan du papier ou de l'écran pour voir l'image en profondeur, la peinture au contraire retient notre regard dans cette épaisseur du plan qui crée une véritable présence des personnages et des objets, même si leurs traits ne sont pas immédiatement identifiables.
Éclats. Les couleurs vives contrastent avec le noir qui prédomine, comme le caractère muet de la nature morte contraste avec les éclats de voix et de rires qu'on devine sur les bouches esquissées, avec les bruits de couverts qui s'entrechoquent. Le silence de la nature morte crée un contrepoint au tumulte d'un dîner en ville, comme lorsqu'on assiste à l'un de ces dîners et que l'on ne fait plus attention à ce que se dit mais que l'on ne perçoit qu'un fond sonore indistinct. Passer du temps à regarder la série des Repas, c'est voir comment des éléments aussi hétérogènes ontologiquement que des corps vivants, des objets fabriqués, des éléments naturels ou des sons « tiennent ensemble ». Le peintre compose une présence. Le piège de la peinture, son échec possible, est la transparence totale, lorsque le spectateur passe au travers de la toile sans voir la peinture. Peindre pour sortir de la figuration. Faire de la peinture pour éviter le piège d'un certain usage de la photographie qui rend les images lisses et muettes. Le peintre est un équilibriste qui évite de passer à travers la fenêtre mais également de s'embourber dans la matérialité de la peinture. Si l'équilibre est atteint, la réalité se tient là, face à nous et nous fait exister face à elle. S'il est rompu dans un sens ou dans l'autre, il n'y a plus rien à voir sur la toile.
A l'heure où les images de toutes sortes surgissent sur nos écrans dans un flux continu, Martin Bruneau s'arrête pour s'installer dans une durée qui nous donne le sentiment d'exister. Peindre prend du temps, regarder la peinture aussi. Pendant ce temps, on n'agit pas. Mais percevoir le temps qui passe est le privilège de ceux qui sont véritablement présents et sentir qu'on existe est une condition pour exercer pleinement sa liberté.