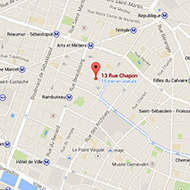Mon approche de la peinture est tragique, brutale, égoïste et existentialiste.
Elle témoigne d'un monde face à des changements jamais rencontrés. L'Homme est sur le point de se replacer dans le Cosmos, à travers sa foi, sa lumière, ses croyances, ses mythes et sa science.
L'aspect historique de la peinture me permet de m'écarter de la culture, pour mieux l'analyser et me mettre en orbite sur le monde.
Walt Disney, Picasso, Goya, Kanye West, Baselitz et Steve Jobs sont des icônes récurrentes dans mes inspirations.
Ma peinture est pour moi un match de boxe au Cesar Palace, une partie d'échec contre Kasparov.
Je peins ma culture, sa médaille et son revers.
Je veux faire se connecter les idées, les concepts, les pensées en une oeuvre issue d'influences pop et historiques.
Pierre AGHAIKIAN (mai 2018)
Pierre Aghaikian : Burn The Witch
Tout comme dans la chanson du groupe de rock anglais Radiohead Burn The Witch, à laquelle la troisième exposition personnelle de Pierre Aghaikian chez Isabelle Gounod et l?une des peintures présentées empruntent leurs titres, le style résolument expressionniste du jeune artiste français est aussi planant que tendu. Récemment diplômé des Beaux-Arts de Paris, Aghaikian a développé depuis deux ans un ensemble de peintures qui revisite d?un souffle vertigineux ce qu?Erró a introduit avec radicalité dans le surréalisme au début des années 1960 : un ouragan de culture pop ! Mais l?analogie s?arrête là. Le maître de la figuration narrative a voyagé aux quatre coins du monde pour constituer des archives sans fond d?images de consommation de masse ? notamment de bandes dessinées ? et continuer ainsi d?alimenter le portrait kaléidoscopique, bien que lisse comme un collage, qu?il dresse de notre temps. Les motifs de la dernière série d?Aghaikian ont quant à eux été excavés des abysses imaginaires du cinéma et des jeux vidéo, avant qu?il ne les détourne et ne les plonge plus encore dans ses empâtements caractéristiques, épais et rocailleux.
À l?aide d?une recette qui lui est propre, un mélange de peinture à l?huile et de poudre de marbre, Aghaikian a donné un semblant d?écorce terrestre, si ce n?est une matière noire, aux larges peintures all-over et compositions de plus petit format qui ponctuent l?exposition. La nature minérale de ces nouvelles oeuvres est d?autant plus manifeste qu?elles mettent en scène un véritable séisme culturel, comme si l?Asie de l?Est avait percuté l?Ouest américain, balayant Hollywood au passage. Rappelant l?univers de la franchise de jeux vidéos Kingdom Hearts, qui a donné son nom à une autre peinture, les visions hallucinatoires de l?artiste embarquent des personnages de dessin animé et de manga chéris dans un paysage de western crépusculaire, dont les aspérités graphiques sont renforcées par les découpes de polystyrène qui encadrent et cisèlent la majorité des grandes toiles, à l?image de cônes volcaniques, ou encore de stalagmites et stalactites. Si les attractions de Disneyland ont directement inspiré la dégringolade fantastique, dans laquelle le peintre a précipité tous les protagonistes de ses tableaux, l?atmosphère apocalyptique étrange, presque souterraine, qui traverse l?ensemble est aussi un clin d?oeil aux films des Frères Cohen et Red Dead Redemption, encore une franchise de jeux vidéos dont le titre d?une autre oeuvre est également tiré.
Dans les champs picturaux surchargés d?Aghaikian, un personnage apparaît plus présent que les autres. Il s?agit d?un cowboy à l?apparence naïve, presqu?enfantine, dont le sourire narquois de smiley semble ironiquement dire tout et son contraire de notre monde contemporain, qui loue et craint à la fois l?abîme technologique, l?extinction de notre espèce, et la force minérale de la nature reprenant ses droits. Il y a une dimension épique dans les oeuvres de l?artiste, particulièrement à ce tournant de l?histoire, alors que les grands héros, loin de manquer, évoluent principalement à travers un excès de plateformes et d?écrans, nous laissant pour seule responsabilité le plaisir addictif de se projeter vainement dans leurs exploits digitaux. Comme un écho au logo de la société de production cinématographique Paramount, et filant à travers la série toute entière, des pluies d?étoiles étincelantes tendent finalement ce grand ?uvre vers de plus hautes sphères. Après tout, quel autre symbole pourrait mieux signifier ici un paradis dantesque au-delà du sombre purgatoire, dans lequel nous engouffre Aghaikain? Les royaumes virtuels ne sont peut-être pas gravés dans le marbre, mais la peinture est certainement plus à même de défier le temps.
Violaine Boutet de Monvel, 2019.
Pierre Aghaikian : Pierre Aghaikian
Que reste-t-il ? De pauvres formes amoindries posées dans un paysage désolé ; rivages épars couleur de paquets de clopes ; quelques auréoles de sainteté, opaques et dures, héritées des temps reculés où l?on croyait encore. Quelque chose de pas tout à fait aimable, ni tout à fait abject.
D?abord, de grandes figures. Héros grisâtres et graves assis sous un ciel lourd. Un berger sans troupeau dans une Arcadie à l?envers, dont les plaines tristes s?éventent à l?infini. Ce qu?on découvre ensuite ressemble à une peinture effondrée sur elle-même. Paysages sans ampleur, brossés a minima au format sarcophage. Verts oxydés, sang de b?uf, de l?écume, de la terre. À peine de quoi regarder. On dirait un linceul usé, et sur ce lit de peinture sale, des dépouilles exténuées, amorphes, écartelées, certaines visitées par des carcasses d?anges, d?autres simplement alanguies, tranquilles au milieu du chaos.
Après l?extrême saturation de ses grandes compositions, Pierre Aghaikian prend assurément un virage plus inquiet. Sa peinture, désormais, tient davantage de la macération. C?est une peinture au bord, au bord du discernable, au bord du supportable, qui se ramasse, aussi, dans une épure plus radicale : économie du geste et des formats autant que de l?intention. D?aucuns seront surpris de cet appauvrissement, qui a quelque chose, il est vrai, d?un à quoi bon ? Question vertigineuse, ou vaine, mais qu?il faut bien poser, formuler, c?est-à-dire, pour le peintre, figurer, et ce même s?il n?y a pas de réponse. Paradoxe du rien qui est cependant quelque chose. Mais alors quoi ?
En premier lieu, un refus, une rétention, presque une méthode pour en montrer le moins possible. Ne pas chercher à faire image, ou plutôt s?évertuer à ne pas faire image. Aveugler la peinture et même la bâillonner, rejeter toute rhétorique, épuiser jusqu?au dernier souffle, et puis? et puis laisser germer dans ses empâtements gras l?étrange inflorescence de l?inquiétude, qui, croissant par le milieu des corps, leur ouvre des bouches en forme de sexes creux, se répand comme une mousse jusqu?à l?extérieur du tableau. Les optimistes y verront une promesse, l?amorce d?un renouveau. Pierre Aghaikian vous dira que ce ne sont que des formes pour combler le vide, et que c?est déjà ça.
Bien entendu, il ne vous aura pas échappé que ça, c?est nous, ces ombres suicidées, ces floraisons exsangues. Il fallait oser le tendre, ce miroir-là. Au bord du supportable, disais-je. Ne reste plus qu?à espérer qu?une carcasse d?ange vienne nous rendre visite, et ce sera déjà ça.
Thibault BISSIRIER, janvier 2023.