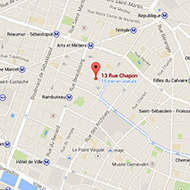Jérémy Liron ? la peinture, hic et nunc.
« L'intuition artistique ressemble en effet aux hallucinations hypnagogiques
par son caractère de fugacité ? ça vous passe devant les yeux -,
c'est alors qu'il faut se jeter dessus, avidement. »
Gustave Flaubert, Correspondances, 1866.
« On n'est jamais à savoir si l'on doit s'accorder au tumulte du monde, en adopter la confusion, en rejoindre l'agitation et les passades, s'y fondre et s'y couler ou y opposer le regard stable, intemporel, droit et glacé de celui qui passe outre . » Jérémy Liron n'est pas seulement peintre, il écrit aussi ? et de fort belle manière. Comme il peint. De lui, on connaît sa série des Paysages périurbains, peints à l'huile, au grand format carré, présentés sous verre de sorte à les mettre à distance comme autant d'arrêts sur image. Une façon de témoignage de l'intérêt de l'artiste pour le cinéma.
Pour sa cinquième exposition personnelle à la galerie Isabelle Gounod, Jérémy Liron nous livre notamment deux grands tableaux à dominante horizontale - deux vues du toit terrasse de la Cité Radieuse de le Corbusier, à Marseille -, à propos desquels il parle d'« hypnagogies ». Le mot n'est pas commun et ne figure dans aucun dictionnaire ; c'est un néologisme que le peintre a déduit du qualificatif « hypnagogique », désireux d'exprimer par là qu'il « tente de capturer ce moment de bascule des images en équilibre entre le dedans et le dehors. » Au regard d'une histoire de l'art contemporain, l'emploi de ce mot ne peut que faire écho à l'exposition qu'en 1948, la galerie Colette Allendy organisait des Photographies hypnagogiques de Raymond Hains, oeuvres abstraites composées en plaçant devant l'objectif des trames de verre cannelé. Simple analogie verbale ou commune préoccupation de réussir à constituer un fait plastique photographique pour l'un, pictural pour l'autre tout en s'appuyant sur le réel sans pour autant vouloir reconstituer une quelconque anecdote ?
L'art de Jérémy Liron est requis par l'idée de présence. S'il a jeté son dévolu sur le monde périphérique de la ville et qu'il a choisi de retenir pour motif de son travail tout un inventaire d'architectures désertées, « s'arrangeant d'un peu de végétation » parfois, c'est que celles-ci s'offrent à voir dans « une présence opaque » et l'assurent tout à la fois de silence, d'aplomb et d'intemporalité. Construites selon un mode minimal qui joue d'une géométrie sensible, de subtils effets de lumière et d'ombre, de plans frontaux et de lignes de fuite, les peintures de Jérémy Liron en appellent par ailleurs au mécanisme de la mémoire. Le temps y est suspendu, l'espace fragmenté. Rien n'y est livré dans une crudité descriptive ; tout relève d'une suggestion, voire d'une évocation au sens où ses images peintes délivrent comme un ton sourd, issu d'un lointain mémorable.
Qu'il s'agisse de ces deux nouvelles et imposantes pièces, de ses toiles « standard », de ses « images inquiètes » ou de ses « images souvenir », la démarche de Jérémy Liron atteste d'une chose, comme il le dit lui-même : « Jamais on n'échappe au contexte ; on ne peut parler que depuis là où, dans l'espace et dans le temps, on se trouve. » Hic et nunc, en quelque sorte. Ici et maintenant, jamais sur le côté. La peinture comme un travelling en profondeur.
Philippe Piguet, 27 février 2014.
---
Jérémy Liron, le faire, le lieu et le temps
Philippe Blanchon, in catalogue de l'exposition de J.Liron à l'Hôtel des Arts de Toulon.
Les interprétations critiques des ?uvres sont multiples et l'artiste a toutes les raisons de se réjouir de cette multiplicité puisqu'au travers de ces interprétations il trouvera confirmation que son oeuvre est du domaine du vivant. Sa sagesse et son assurance devraient s'en trouver accrues. Cependant le vivant est incernable. Musil le dit clairement : devant une oeuvre d'art aucune « affirmation entièrement rationnelle » n'est possible car nous nous trouvons confronter à « une émotion sans paroles, une expérience vécue ». Il précise : « le tableau doit, justement, comporter une expérience vécue que les mots ou la pensée ne sauraient inclure ». Pourtant nous écrivons sur la peinture, nous tentons cet impossible car tous les possibles demeurent par la pensée agissante. Ces possibles sont nécessaires comme l'existence, ils confrontent nos expériences avec leur potentiel de vérités et de divagations. Assumons nos postulats après ces quelques précautions.
S'agissant de la peinture de Jérémy Liron, deux mots viennent spontanément à l'esprit : parcours et architecture. Néanmoins rien ne saurait réduire le travail d'un artiste à quelques vocables. Il ne peut être oublié que nous avons affaire à un peintre dont les préoccupations, la logique interne dominent et sont commandées in fine par un mystère et en toute conscience Liron affirme : « Le sujet invite des gestes de peinture ». Ce sont ces gestes qui en font le mystère car quelque chose échappe à l?artiste, à tout artiste quel que soit son souci de rigueur, quelle que soit son exigence. « L'intérêt est dans l'écart, la surprise » nous dit le peintre. Nous pourrions même affirmer que ce qui échappe à l'artiste est proportionnel à son exigence, à la consistance qu'il projette, que tous les faits plastiques qui comptent confirment invariablement ce phénomène.
Parcours donc, de Paris et de ses zones limitrophes (Vitry sur Seine, Sarcelles, Créteil) à la méditerranée (ses corniches), de Valencienne à Paris, de Montluçon jusqu'à Lyon enfin dans le parcours-dérive Lyon-Béthune. Chaque lieu, ayant provoqué un travail spécifique, provoquera une exposition, elle-même pensée comme un « récit ». Dans la présente exposition, par la conception même de l'accrochage, c?est le récit de ces récits qui se trouve ainsi concentré. C'est l?évolution d'un peintre dans son souci constant quant au métier et soucieux d'une relation au monde qui soit poétique essentiellement.
Il y a ce que l'il perçoit immédiatement (et ce qu'une longue fréquentation de l'oeuvre confirme dans le choix, les sujets notamment, mais aussi bien, les techniques, les moyens investis et, par cette évolution conjointe du peintre et de sa peinture, une atmosphère singulière s'affirmant « dans la solitude ».
Parcours, avons-nous dit, et architecture, car il semblerait bien que le parcours de l'il de l'artiste (son souci architectural) en différentes géographies, ait imposé ces motifs et ces motifs sont pour l'essentiel des faits d'architecture. Chaque tableau est pour l'artiste une « station », « dressé dans l'espace, comme menhirs ou immeubles », mais encore « comme une figure », renvoyant au sens du tableau : la verticalité et les résonances poétiques.
Le terme « landscape », utilisé lors de la première exposition importante de Jérémy Liron, recouvre une série de toiles (dont certaines « abstraites »). Il explique avoir commencé à peindre des immeubles, saisi par leur surgissement dans le paysage. Nous pourrions insister sur cette question du « landscape », le mettre en rapport avec le « paysage », et grâce à l'étymologie, relever la différence essentielle entre « land » et « pays ». Mais conservons par convention ici ce mot de « paysage » et posons-nous la question suivante : Jérémy Liron aurait-il peint seulement la plaine, ce lieu désolé ou peu boisé, « d'où rien ne surgit », comme l'ont fait un Corot, un impressionniste ou encore Van Gogh dans un autre temps ? Je le crois. Je le crois d'autant plus que cet artiste, quand son travail subit une évaluation à partir d'une grille de lecture strictement sociologique, faisant prévaloir le sujet sur les moyens de son exécution, ne reconnaît plus son univers. Il insiste sur cette primauté du peintre en lui : « Très tôt en fait, j'en ai pris conscience il y a quelques années, j'ai porté sur le monde un regard de peintre. J'avais quinze ans et dans les jeux de nuages je regardais des aplats, des glacis, des dégradés de couleurs. »
Oui, les sujets traités participent à situer un artiste dans une époque ; bien sûr, ils rendent compte ainsi de l'état d'une société et d'une culture à un moment précis mais pour tout peintre, et donc pour Liron, les préoccupations sont essentiellement picturales (« est-ce que ça tient ? » est la question centrale). « Une architecture, on ne peut la démonter en pièce dont chacune garde une autonomie ou une vie isolée. Un fragment d'architecture ne peut être qu'un morceau bizarre et tronqué qui n'a de l'existence que juste à la place où il doit se trouver. La construction n'est que l'imitation de l'architecture. » déclare Juan Gris : nuance de taille quand on songe au souci de synthèse qui doit animer le peintre dans l'exécution du tableau, vision éminemment moderne de la peinture pour qu'une permanence lui soit assurée. La question du choix du sujet se situe ailleurs. Je pense ici à Degas et à sa méfiance devant la littérature faite autour du travail du peintre, à sa condamnation d'un regard extérieur, regard qui trouve sa caricature dans le discours sociologique, privé de la chose essentielle : le poétique d'une oeuvre. Paul Valéry a écrit sur la « Poésie » et l'état qu'on lui prête : « Cet état est de résonance. Je veux dire, - mais comment dire ? - que tout système de notre vie sensitive et spirituelle s'en trouvant saisi, il se produit une sorte de liaison harmonique et réciproque entre nos impressions, nos idées, nos impulsions, nos moyens d'expression ; comme si toutes nos facultés devenaient tout à coup commensurables entre elles. » Notez le « comment dire ? », car si mettre des mots sur la peinture est une gageur il en est de même quant à la poésie (ce qui, même, la caractérise).
Ces lieux indéterminés, immeubles jaillissant dans la plaine, parfois aperçu d'un train, d'une voiture, sont pour une génération née avec eux, possiblement « chargée de poésie », comme les stations services d'autoroutes, etc. Nous pourrions tenter de démêler la part de l'art et de la vie, l'importance du cinéma, de la photographie, etc. mais dans le même temps cette poésie a pu se manifester à des enfances vierges de culture? Les choix se font de nouvelles géographies, imposés partiellement par les circonstances ; mais l'artiste se tient, saisit autant qu'il peut dans tout ce qui le traverse, dans la solitude de l'atelier, avec ses réminiscences, c'est là l'essentiel.
Georges Poulet a écrit : « L'être privé de lieu est sans univers, sans foyer, sans feu ni lieu ». Il démontre qu'espace et temps ne font qu'un pour l'auteur de La Recherche du temps perdu. Proust dit : « Le temps y a pris la forme de l'espace ». Jérémy Liron peint des lieux mais aussi des moments, des fragments d'espace (« témoignant » de l'architecture de son époque) et des fragments de temps (ainsi avons-nous parlé de « récit »). L'essence poétique de son travail est là aussi, dans ce « renversement » qui se neutralise. L'artiste vit au coeur de cette tension. S'il doit relever les défis propres à son art, il sait simultanément que cette réalité poétique fait notre humanité : lieu et temps fusionnant pour l'abstraction de toute oeuvre.
Jérémy Liron est ainsi proche de Proust lorsqu'il parle volontiers d'intuitions (« obsession inexplicable »), d'énigmatiques apparitions (s'angoissant de leur perte éventuelle) quand il aborde les moments de travail à l'atelier. Il parle essentiellement en peintre car si « toute conscience est rétrospective » c'est parce que le tableau « se construit par des nécessité internes dont nous n'avons pas le plan ». Nous voudrions souligner ici, en passant, que Liron est aussi un critique avisé, que sa curiosité et sa connaissance de l'art de ses contemporains lui permet d'écrire livres et articles de première importance par sa lucidité, et qu'enfin, comme lecteur rigoureux, il mène une réflexion riche et ouverte sur l'art et sur la littérature (avec laquelle il entretient une relation centrale), d'où la multiplicité de ses interrogations. Ainsi parle-t-il de la « syntaxe de [ses] tableaux » et ajoute-t-il : « Sans doute, à un moment, cette liberté prise par la langue, par la recherche littéraire, a ravivé ce désir qu'il y avait dans ma peinture ». Dans le parcours, que lui-même souligne, à travers la constitution de l'exposition, il revient sur le fait qu'il changera de motifs, des immeubles et des terrains vagues aux villas méditerranéennes de son enfance, lorsqu'il se sentira enfermé par une certaine critique dans une « catégorie » repérable sociologiquement. Devant un regard systématisant Liron se trouve amputé de sa vie intérieure, de sa poétique.
« Dans la solitude » avons-nous dit, reprenant le titre d'une de ses plus récentes expositions mais, contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'absence de présence humaine dans ces toiles, semblant justement incarner cette solitude, n'est qu'un leurre. L'homme est présent à travers les mains qui ont façonné ces paysages : immeubles, maisons, parcs, carrières, etc. même dans le cas d'un arbre seul, devant une fenêtre, on voit le carré de terre que les hommes ont cerné pour lui : les mains des hommes et la main du peintre qui singularise ses tableaux. Ces objets privilégiés par Jérémy Liron, (l'artiste nécessairement omniprésent par ses choix, sa main, son il, sa subjectivité objective qui est l'art même) proposent une oeuvre très humaine, amoureuse, poétique (pensez à la poésie de Pierre Reverdy autant qu'à celle de William Carlos Williams, de George Oppen, dans leur attention aux détails, aux objets comme sujets).
L'absence de représentation n'est pas l'absence. Qu'il s'agisse des hommes, mais tout autant de la mer, qui dans les séries des « balnéaires » est « devinée ». Cette absence de représentation humaine peut nous laisser entendre que « dans la solitude », propre à quelque enfance, quand soudain elle apparaît, présence révélatrice du moi, l'artiste se tient, tenu par son amour de cette solitude lui ayant permis la découverte, sans intrusion, de sa subjectivité à travers l'objectivité. Le monde alors peut se restituer pour tous. Ce qui renvoie ici à quelque enfance, c'est ce regard premier, qui sera décisif pour toute une vie (quelle soit celle d'un artiste ou non), elle est le terrain propice aux chocs élémentaires des premières révélations, aussi bien à travers les sens qu'à travers l'esprit s'exerçant à penser. Jérémy Liron se dit « happé par la forme de l'énigme ». Il faut donc que l'énigme prenne forme, et cela pourrait bien être, à travers cette enfance, cette solitude, la définition elliptique de l'art poétique.
Ce cheminement est inséparable d'une évolution permanente de son travail pictural, d'une précision et d'une maîtrise croissantes. Le travail conscient et le travail inconscient ne peuvent être que simultanés (comme espace et temps).
Permettez-moi une digression ici : Une fin d'après-midi, en été, je faisais face à de grands platanes alignés et parfaitement contrastés. Leurs troncs sont sombres, à l'ombre, et leur feuillage offre au regard, immédiatement, la partie exposée au soleil. Le soleil y crée quantité de nuances. Quelques feuilles semblent s'isoler, s'illuminent. L'autre masse, sombre, offre moins de nuances. Regardant cela, comment ne pas penser aux impressionnistes et surtout comment ne pas se demander si ce spectacle est d'une beauté intrinsèque ou si mon esprit en jouit formé par ces peintres ? Comment cela était-il perçu avant leur avènement, telle est la question ? Je ne parvenais à trancher. La chose semblait tellement évidente qu'il me semblait impossible qu'elle n'ait pas ému les hommes depuis toujours, que les impressionnistes n'avaient que révélé, souligné, rendu objectifs des phénomènes perçus par d'innombrables subjectivités. Folie et mystère de la peinture. Comme chacun ressent, perçoit ; l'artiste, lui, réalise. C'est là un vieux débat qui finissait de me diviser alors que j'avais cru jadis, comme Wilde, que « La vie imite l'art ». Il m'apparaissait soudainement que tout cela était plus complexe, qu'il y avait un très subtil jeu de vase communiquant. Que si l'art fixe une intuition, réalise une sensation, intuition et sensation préexistent tout autant à cette réalisation.
Ce n'est pas m'éloigner de la peinture de Jérémy Liron que de poser de tels prédicats, car accepter qu'il y ait interpénétration de tous les phénomènes de l'esprit, c'est aller au-devant d'eux, pouvoir parler de leur poésie, de ce qui en constitue la spécificité. L'art et le reste des activités humaines sont inextricablement mêlés. C'est vrai des choses les plus élémentaires ou des choses les plus complexes, de nos sensations jusqu'à nos sciences (Juan Gris soulignait que De Vinci peignait les nuages de façon révolutionnaire aussi parce qu'il savait qu'ils étaient faits de vapeur d'eau et Jérémy Liron souligne que l'invention du tube de couleur est une des raisons de la peinture sur le motif et des révolutions conséquentes). Chaque période humaine a ses priorités, elle commande à l'artiste sans que ce dernier ait besoin d'en être parfaitement conscient. La sensation, la science, le mythe, le symbole, l'enfance, etc. viennent interférer dans son travail, comme le physiologique, le chimique, etc. Les plus conscients s'interrogent, tentent de définir leurs frontières, ainsi de Jérémy Liron.
Revenons à l'abstraction évoquée : toute oeuvre qui compte est abstraite, qu'elle soit figurative ou non, selon les conventions imposées. Que les schèmes aillent s'épurant dans le travail de Liron n'en est qu'une illustration toute superficielle comme il s'agit, dit-il, de « prélever [?] d'infinies variations ». Ce que l'on nomme « influences » y participe. Giorgio Morandi, Per Kirkeby, Edward Hopper, Sean Scully, Edvard Munch, Roger Van Rogger, Balthus, Mark Rothko ; sans parler des grands prédécesseurs, Rembrandt, Vélasquez, Vermeer, etc. Jérémy Liron assume son amour de la peinture. Ainsi, si les tableaux sont remarquablement « abstraits » dans leur motif (le gros plan), il ne faut pas oublier qu'ils n'en sont pas moins abstraits dans les toiles où le motif est immédiatement « lisible » (le plan large).
Pour illustrer les multiples allusions qui ont émaillé mon propos, je voudrais pour finir, entrer plus avant dans la genèse et les étapes successives ayant amené à l'achèvement de la pièce la plus récente de l'exposition, son polyptyque (Paysage n°90) conçu précisément pour cette occasion. Quand j'insiste sur le fait que Jérémy Liron est peintre, et ce faisant l'inscris dans une généalogie, c'est afin de rendre ces problématiques en partage avec celles de ses aînés : Comment composer en fonction de l'espace (la toile ou la feuille), quel sujet (ou absence) ? Comment rendre, à l'intérieur de chaque espace spécifique chaque fragment aussi vivant que l'ensemble ? Dans le cas particulier de cette grande pièce, il s'est posé à l'artiste, comme à d'autres avant lui, le problème d'une oeuvre à concevoir pour un lieu particulier.
Liron explique volontiers la genèse de ses tableaux, le saisissement, « une silhouette [?] qui s'impose ». Ici, ce bâtiment qui apparaît « assez majestueusement ». Impérativement, il faut qu'il y ait résonance, au sens proustien. Le sujet s'impose, le lieu qui doit faire sujet pour le tableau qui devra lui-même s'intégrer dans un lieu : lieu pour lieu, espace pour espace. Mais n'oublions pas ce que souligne Jacques Bouveresse : « L'acte motivé n'a pas besoin d'être le produit de la volonté libre et ne l'est généralement pas (pas plus, nous dit Musil, que le motif que trouve à un moment donné le peintre et qui, d'une certaine façon, s'empare de lui n'a à voir avec l'intention et la volonté, dont on pourrait dire au contraire, en exagérant un peu, qu'il les détruits plutôt). »
L'incernable de la motivation initiale ayant été redite, il reste, pour le peintre à réaliser, et à chaque étape, à résoudre différentes difficultés. Si le ciel est ainsi, le bâtiment doit-il être comme cela ? Et le premier plan ? Et la végétation qui s'impose entre les deux ? Aller vers le détail ou aller vers la schématisation ? Donner de la densité par la forme générale dominant (comme chez un Munch, par exemple) ou bien, à force de coups de brosses signifier une forme plus particulière ? Gérer cette étrange coexistence du parti pris du peintre et des contraintes propres au tableau.
L'artiste « happé par l'énigme », « à la frontière du sauvage, comme à longer le bord de la nuit », pose les bases du tableau, son architecture, « quelques tracés sommaires », ses premiers glacis. La courbe, en haut, qui cadre, comme à travers un pare-brise. Des couleurs s'imposent, s'opposent immédiatement, et déjà cette certitude qu'à chaque avancée « tout peut s'écrouler ». Le ton local s'impose tout d'abord, et certains détails « naturels » trouvent encore leur expression. Ensuite, et c'est là que ce qui échappe domine : des masses interviennent, la végétation perd son « ton local » en se simplifiant, le ciel perd son bleu initial et ses nuances, l'immeuble, de « réaliste » devient forme autonome et tout autant celles de Jérémy Liron émergent précisément : la composition du tableau est prédominante sur le fragment de réel qui l'a inspiré. L'équilibre des masses devient central, les glacis disparaissent, des aplats apparaissent, les couleurs se contaminent. L'ensemble devient plus monochrome, et si la couleur revient, elle s'affirmera alors sur cette neutralité toute apparente (car « les plus petits contrastes sont les plus grands » comme le disait Van Rogger). Le bleu à nouveau, coulé dans le ciel, « flaque pâle », un vert nouveau, brossé, pour le végétal. Il y a la crainte de l'intrusion d'un autre pour la résolution des difficultés et la reprise en main par l'oubli de ce qui n'est pas nécessaire précisément. En ses six toiles, d'étranges cohabitations laissent deviner des possibles. Ce qui fut schématisé est repris par touches, traces nuançant, créant ces résonances qui poétisent. Enfin, les possibilités s'amoindrissent, une solution finale, unique, se profile et s'impose. L'artiste nous la restitue, la laisse venir en agissant, aussi il prouvera qu'il est peintre, seulement peintre. Voilà ce que Jérémy Liron réalise.
---
La négation du monde
Philippe Dagen, 2007.
Entre autres définitions possibles de l'homme occidental actuel, celle-ci : c'est l'être qui voit le monde sur un écran et à travers une vitre. Les preuves sont inutiles, l'expérience commune suffit à établir sa pertinence. Il y a quelques années, sur les grilles du jardin du Luxembourg, un photographe qui a fondé sa réputation sur les clichés pris d'avion ou d'hélicoptère faisait l'apologie des splendeurs de la planète à deux ou trois cents mètres d'altitude. A cette hauteur, évidemment, les misères humaines ne se voient plus et un campement de tentes pour réfugiés peut devenir une figure géométrique aussi séduisante que des rochers dans le désert ou des marais salants. Cet esthétisme commode, à vocation publicitaire, est moralement détestable, mais il est aussi admirablement exemplaire de ce regard à distance, de plus en plus à distance ; distance de protection, distance de contemplation- que nous pratiquons sans y penser. Confort maximum.
Le monde, c'est quoi, vu d'ici ? Un spectacle continu. La nature ? Un fondu enchaîné par les baies d'un train ou d'une automobile. Quand le monde cesse d'être un spectacle, toutes sortes d'accidents deviennent possibles ; des révolutions pour employer un mot ancien, passé de mode. Heureusement, il n'y a plus de révolutionnaires, mais des émeutiers dont la revendication principale est de passer au journal télévisé. Quand la nature casse les baies, ce ne peut être que par temps de tempête ; une tempête qui est un spectacle partout, à l'exception du lieu où elle s'abat. Quant à la nature animale, il est entendu qu'elle n'est acceptable que domestiquée ou alors sous forme de zoos et de documentaires.
Cet état de la vie s'appelle séparation. Les sociétés occidentales modernes et prospères vivent sous le régime de la séparation. Les jeux virtuels et les images numériques ne sont que des manifestations extrêmes de cet état de fait.
(Ici, si mon propos n'était pas d'en venir à quelques tableaux d'un jeune artiste, je m'autoriserais une digression sur les imageries de la sauvagerie et de la catastrophe dans l'industrie cinématographique récente, histoire de montrer comment celle-ci satisfait tout à la fois la nostalgie de plus en plus épuisée d'un autre mode de vie ; où le monde et la nature existaient encore réellement- et le désir terrifié de se prémunir contre tout ce qui mettrait en danger notre confort : grâce au Ciel, ce n'était qu'un film, cette glaciation, cette inondation, cette guerre ; nous étions au spectacle, un spectacle qui nous montre combien ce serait terrible si nous cessions de jouir du contrôle de tout- du contrôle à distance évidemment.)
Le rapport avec les travaux de Jeremy Liron ; Son exigence que ses peintures soient présentées sous verre ou plexiglas. Elles n'en ont aucun besoin matériel, elles ne sont pas fragiles et, pour l'heure, elles ne sont pas non plus si coûteuses que cette précaution s'impose. N'empêche, les notices précisent toutes : « huile sur toile, 122 cm x 122 cm, cadre chêne et verre organique ». Lui-même, dans son atelier, ne manque pas de le redire : il faudrait ne jamais voir ses peintures sans cet appareil. La raison ; Il veut que l'on ne puisse voir sa peinture que comme l'on voit, désormais, le monde, à travers une vitre. Il veut que la séparation s'accomplisse physiquement et qu'aucune sensation fallacieuse de proximité ne soit possible. Et, à vrai dire, que la plupart des sensations soient exclues : celles qui ont rapport à l'atmosphère et au mouvement comme celles qui suggèreraient des sons, de l'air, du vent ou même des odeurs. Ces jouissances, dont les paysagistes ont souvent fait leurs délices, ne sont pas tolérables ici. Quant aux jouissances picturales, elles sont contrariées : Liron pourrait se plaire à évoquer des cieux nuancés, la lumière sur et entre les feuilles, l'immensité de l?espace. Il pourrait au moins s'autoriser quelque délicate virtuosité dans le traitement de la pierre, de l'écorce et de la terre. Mais non : il se soucie peu de finir sa toile, laisse parfois sa partie inférieure à l'abandon et admet que les couleurs ne respectent pas exactement les limites qu'un dessin descriptif leur aurait assignées.
Si les motifs de ses toiles sont aisés à reconnaître et à nommer, la représentation est plus d'indication que d'imitation ; d'indication qui peuvent s'en tenir au sommaire et au brutal.
Or il se trouve, sans que cela puisse passer pour une coïncidence, que les motifs de ces paysages se caractérisent par une dureté égale ; dureté qui est, à nouveau encore, question de séparation. Liron, vite regardé, peut passer pour un peintre d'architectures contemporaines. D'architectures sans qualités particulières : à l'exception de la Cité radieuse, les bâtiments qui l'ont retenus jusqu'ici relèvent au mieux du tout venant du logement en série en béton, du siège social banalement néo-moderne en aluminium et verre fumé ou du préfabriqué posé sur sa dalle coulée en une journée. Dès lors, il se pourrait que sa préférence pour de tels édifices médiocres ne soit qu'une concession au sociologisme actuel, si tyrannique qu'il n'y a plus guère de jeune photographe qui ne se croit obligé de s'en aller du côté des grands ensembles, des « quartiers sensibles » et banlieues désolantes des métropoles ; sociologisme et misérabilisme pour tirages couleurs. Une deuxième explication se fonderait sur les conditions de vie de l'artiste : pour se rendre à son atelier, il lui faut traverser en voiture l'une de ces zones autour de Lyon où les supermarchés, les entrepôts, les usines, les barres, les espaces supposés verts, les terrains vagues et des lambeaux de terres agricoles encore cultivés se juxtaposent dans un désordre qu'aucun urbaniste n'a tenté de rendre acceptable ; les urbanistes préfèrent intervenir dans les centres historiques, où leurs traces se voient mieux et suscitent des débats. Cet itinéraire pourrait l'avoir inspiré ; si ce n'est qu'il travaille ainsi depuis plusieurs années et qu'il serait sans doute plus juste de supposer qu'il s'est décidé pour cet endroit parce qu'il s'accorde à ce qu'il peint ; pas des architectures seulement, mais leur rapport avec les lieux.
A mieux y regarder en effet, Liron ne peint pas des immeubles, des tours ou des villas : il peint des constructions dans les champs, des villas entre des arbres et des rochers, une usine dans un pré. Il peint leur intrusion. Il peint l'irruption de leurs volumes anguleux et de leurs murs droits dans ce qui était, auparavant, il y a plus ou moins longtemps, un bois ou une vallée. Des barrières et des grillages découpent l'espace et quelques indices permettent d'imaginer encore à demi ce qui était là, autrefois, avant ces découpages, avant ces séparations. Des plans de béton blanchi ou de brique rouge tombent comme des lames. Des lignes sombres coupent à travers de la toile. Les terrasses écornent le ciel. Les fondations scient la terre. Il y a quelque chose d'inguérissable et d'impardonnable dans ces vues d'aujourd'hui, quelque chose qui fait confondre ces constructions avec des tombeaux et qui rappelle d'anciens souvenirs de peinture, ces paysages du XVII° siècle bâtis de terrasses, d'escaliers et de pyramides incongrus parmi les rocs et les sources des montagnes. A cette différence près que ceux-ci opposaient le chaos de la nature à l'harmonieuse géométrie humaine alors que, désormais, la monstrueuse géométrie humaine insulte ce qui pourrait rester de désordre quelque part. On n'en sortira pas.
Même en esprit, on n'en sortira pas. Parlant avec Liron, nous en sommes venus à évoquer cette manie que nous avons ; et ne nous est pas propre- de comparer aussitôt un lieu, quel qu'il soit, aux représentations picturales que nous conservons dans notre mémoire comme un répertoire de modèles et de références. Des essais ont été écrits sur cette « artialisation » du paysage, sur ce processus de classement par comparaisons. Il n'y a rien, de nouveau à en dire aujourd'hui, si ce n'est que, décidément, nous ne sommes plus capable que de reconnaître des images que nous avons déjà vues ; ou des images qui leur ressemblent de très près. Nous fonctionnons d'après des catalogues d'autant plus prestigieux que les contributeurs se nomment Lorrain et Vermeer, Cézanne et Hopper.
Mais de quoi ce mode de perception par reconnaissance est-il l'indice ? Et où est-il de règle, si ce n'est dans le monde de l'intelligence artificiel et des banques de données ? A croire que nous en sommes arrivés à ce stade où nous percevons moins que nous n'identifions et où le monde, spectacle décidément, n'est plus accessible que comme une bibliothèque d'images, les unes venues de la peinture et d'autres, en nombre évidemment croissant, du cinéma et de la télévision.
Nous ne passons plus dans des « forêts de symboles », comme Baudelaire, mais le long de galeries de stéréotypes familiers et à la poétique du voyage s'est substituée l'économie du tourisme, qui n'est le plus souvent là encore que reconnaissances et vérifications du bien fondé des réputations et de la précision des guides. Dans ce monde fini, désespérément fini, il ne reste plus guère de probabilité de découvertes, rien que l'amère délectation du déjà vu et du déjà là.
Liron peint la négation du monde, qui est désormais notre monde.