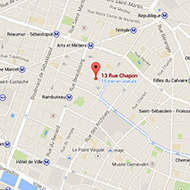PIERRE AGHAIKIAN
Que reste-t-il ? De pauvres formes amoindries posées dans un paysage désolé ; rivages épars couleur de paquets de clopes ; quelques auréoles de sainteté, opaques et dures, héritées des temps reculés où l’on croyait encore. Quelque chose de pas tout à fait aimable, ni tout à fait abject. Voilà le peu que Pierre Aghaikian a rapporté du fond de la grotte. Mais, détaillons.
D’abord, de grandes figures, presque plus grandes que nous. Héros grisâtres et graves assis sous un ciel lourd. Promeneur des bords de gouffre. Un berger sans troupeau dans une Arcadie à l’envers dont les plaines tristes s’éventent à l’infini. Une montagne tente de dominer un lac, dont les eaux noires ne reflètent plus les astres. Plantés droits sur leurs pics, deux têtes de porcs tranchées, du moins ce qu’il en reste.
Si ce n’est leurs masques menaçants, ces pesantes sentinelles n’ont à vrai dire rien d’un cerbère, elles ne nous empêchent pas de passer. Notez qu’elles ne nous y invitent pas non plus. Au fond, elles s’en moquent et je crois que s’il leur restait des gorges, on les entendrait rire. Seulement, de cela aussi, elles ont perdu la force. Aussi passons, sans crainte, mais sans espoir.
Ce qu’on découvre ensuite ressemble à une peinture effondrée sur elle-même. Paysages sans ampleur, brossés a minima au format sarcophage. Verts oxydés, sang de boeuf, de l’écume, de la terre. À peine de quoi regarder. On dirait un linceul usé, et sur ce lit de peinture sale, des dépouilles exténuées, amorphes, écartelées, certaines visitées par des carcasses d’anges, d’autres simplement alanguies, tranquilles au milieu du chaos. Ailleurs, de vieilles idoles cavernicoles, revenues du fond des âges, jouent au fakir au bout de leurs pieux. Ici, le titre renvoie au texte de Georges Bataille, L’anus solaire. La référence est poétique, elle chante la fin d’un ordre et la débâcle. Notre débâcle.
Après l’extrême saturation de ses grandes compositions, Pierre Aghaikian prend assurément un virage plus inquiet. Sa peinture, désormais, tient davantage de la macération. C’est une peinture au bord, au bord du discernable, au bord du supportable, qui se ramasse, aussi, dans une épure plus radicale : économie du geste et des formats autant que de l’intention.
D’aucuns seront surpris de cet appauvrissement, qui a quelque chose, il est vrai, d’un à quoi bon ? Question vertigineuse, ou vaine, mais qu’il faut bien poser, formuler, c’est-à-dire, pour le peintre, figurer, et ce même s’il n’y a pas de réponse. Paradoxe du rien qui est cependant quelque chose. Mais alors quoi ?
En premier lieu, un refus, une rétention, presque une méthode pour en montrer le moins possible. Ne pas chercher à faire image, ou plutôt s’évertuer à ne pas faire image. Aveugler la peinture et même la bâillonner, se prémunir de toute emphase, refuser de séduire, rejeter toute rhétorique, épuiser jusqu’au dernier souffle, et puis… et puis laisser germer dans ses empâtements gras l’étrange inflorescence de l’inquiétude, qui, croissant par le milieu des corps, leur ouvre des bouches en forme de sexes creux, se cristallise en colonne vertébrale et en architectures fantoches, se répand comme une mousse jusqu’à l’extérieur du tableau, dont elle fleurit les bords.
Les optimistes y verront une promesse, l’amorce d’un renouveau, comme un printemps. Pierre Aghaikian vous dira que ce ne sont que des formes pour combler le vide, et que c’est déjà ça.
Bien entendu, il ne vous aura pas échappé que ça, c’est nous, ces ombres suicidées, ces floraisons exsangues. Il fallait oser le tendre, ce miroir-là. Au bord du supportable, disais-je. Ne reste plus qu’à espérer qu’une carcasse d’ange vienne nous rendre visite, et ce sera déjà ça.
Thibault BISSIRIER, janvier 2023