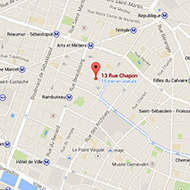Peinture myriade.
La peinture d’Axel Pahlavi ressemble à une église sans toit ouverte sur le ciel et les intempéries. Une ruine qui se serait laissée envahir par la végétation. Elle est un réceptacle ouvert et poreux. Tel un socle qui tient mais accueille le foisonnement tremblant de la vie. Comme si l’artiste tentait de donner un visage au corps d’une peinture morcelée, tiraillée par des tensions schizophréniques. Le corps de sa peinture rassemble la multiplicité du corps du monde qui le traverse : myriade de vies, de rencontres, qui s’incarnent dans sa manière même de peindre. À l’image de la vie qu’elle reçoit, la peinture d’Axel Pahlavi se veut hétérogène, vacillante, changeante. Elle défie et le temps et le lieu, rassemblant l’ici et l’ailleurs, errant du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest.
Cette porosité de la peinture d’Axel Pahlavi est avant toute chose liée à une histoire intime et personnelle. Chrétien et croyant, né en Iran, Axel Pahlavi partage sa vie avec l’artiste Florence Obrecht, originaire de Metz, dont les parents se sont éloignés de la religion. De par leurs histoires et leurs lieux de vie, entre Paris et Berlin, entre la Lorraine et l’arrière-pays niçois, ce couple rassemble, dans la chair de leur amour comme de leur peinture, une myriade d’éléments hétérogènes, embrassant diverses cultures, identités, sensibilités, paysages, langages. C’est une même hétérogénéité qui caractérise les fondations de la peinture d’Axel Pahlavi, entre culture iranienne et européenne, traditions et modernités, réalisme concret et élan mystique, classicisme et expressionnisme. Les deux premières personnes qui lui ont enseigné la peinture sont Maître Behnam (peintre iranien, il réalisait des affiches pour le cinéma et a été formé par Kamâl-Ol-Molk, peintre de miniatures persanes, initié à l’art européen et ayant fréquenté l’atelier de Fantin-Latour) et sa grand-mère (formée dans une académie bourgeoise de Paris). Et l’on sait l’importance que jouèrent, aux Beaux-Arts de Paris, ses études dans l’atelier de Vladimir Velickovic. Autant de rencontres et d’empreintes picturales dont l’œuvre d’Axel Pahlavi gardera la trace.
Mais cette porosité est aussi liée à l’histoire d’une génération. Né en 1975, Axel Pahlavi fait partie d’une génération qui chevauche et la fin d’un siècle et le début d’un autre. Il traverse une époque qui évolue vitesse grand V. Une époque qui semble n’avoir plus d’âge, plus de frontières. Hier le livre, aujourd’hui la vidéosphère, internet, Netflix et les réseaux sociaux. Les approches du monde, de la culture et du temps ont considérablement changé. La planète s’est ouverte à la mondialisation, le capitalisme et son consumérisme nous assaillent d’un flux ininterrompu d’offres et d’images. Tout est accessible, de n’importe où, n’importe quand. Et le grand art et les séries télévisées. Et les guerres et le désir d’immortalité. Nous basculons comme un TGV d’une idée à une autre, d’un ressenti à un autre, d’une image à une autre, d’une culture à une autre, d’une langue à une autre. Et nous n’attrapons au vol que des morceaux de ce nouveau monde. Morceaux de croyances et de désillusions, d’idéal et de perversion, de beauté et de laideur, de profane et de sacré, de désir et de renoncement. Axel Pahlavi fait partie d’une génération d’artistes qui a choisi d’affirmer la persistance de l’image peinte et dessinée. Et cette persistance n’a pu se faire qu’en faisant face à cet état morcelé du monde, assemblé, incarné, dans le corps de l’œuvre. Une œuvre du fragment et de la cassure, de l’hybridation et de la suture. Les espaces et les lumières, les manières et les écritures, les motifs viennent d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui : tous sont le lieu de tensions contradictoires, de sources hétérogènes, d’échelles et de perceptions multiples, d’âges et d’origines diverses.
Plus que jamais, la nouvelle exposition d’Axel Pahlavi, chez Isabelle Gounod, s’ouvre sous le signe de l’ouverture et de la porosité. Les œuvres présentées relèvent de diverses écritures. Ici, une manière très écrite, graphique, poussée, serrée, comme dans certains portraits ou grandes compositions allégoriques. Là, une écriture plus déliée, ouverte, floue, diluée, inachevée. Il y a dans ce corpus des œuvres qui ont été réalisées sur le motif, dans l’arrière-pays niçois, à un moment où l’artiste se confronte à la puissance de la nature et à sa beauté fugitive (comme « Sang de la création », « Triptyque de la grâce » et « Triptyque de la création » ; trois tableaux d’après lesquels l’artiste a réalisé à l’atelier « Buisson ardent » et « Aux forges du temps »).
Cette diversité des manières procède d’une multiplicité des outils, médiums, supports : lavis, gouache, crayon, huile, tempera, papier, bois, pinceau, aérographe... De même que l’hétérogénéité de la forme se nourrit d’un héritage hétéroclite. Ici quelque chose d’une mystique venue de l’Est, là un espace réel presque vulgaire plus proche de l’Ouest. Et s’il fait écho cette fois-ci au postimpressionnisme, aux nabis, à Vuillard, le travail d’Axel n’en porte pas moins la trace d’un goût permanent, ici, pour l’école italienne, là pour la peinture expressionniste contemporaine. Un apport qui se trouve mêlé à celui d’une culture populaire tout aussi fondatrice : on retrouve le goût de l’artiste pour l’art mineur des années 1970, la mauvaise illustration de séries B, l’heroic fantasy, le cinéma et la bande dessinée de science-fiction.
Tout revient, par cycles, comme un principe de spirales, d’éternel retour. Tout meurt et renait, par transformation.
Il y a, dans cette hétérogénéité, une tentative d’unir des sensations et des émotions contraires. Quelque chose de la vérité et du fantasme, du réalisme et de la naïveté, du beau et du mauvais goût, du rire et du tragique, du nocturne et du lumineux, de l’ordre et du chaotique. Quelque chose d’impossible qui tient d’une instabilité presque schizophrénique. Comme une obsession de maintenir à la fois une expérience allégorique et une relation très physique avec le réel. Quelque chose de mystique mais de très concret. Sorte de voyage spirituel, aérien, qui se nourrirait de la terre. De la terre, donc du corps.
Hormis les quelques représentations de nature réalisées sur le motif, la majorité des œuvres est centrée sur la figure humaine. Celle-ci demeure essentielle, comme toujours dans le travail d’Axel. On retrouve en nombre, les représentations de sa famille, Florence sa femme, père et grand-père. Et aussi ses proches et amis. Mais plus que jamais, ces visages familiers s’incarnent dans une peinture myriade qui accueille une hétérogénéité. Regardez ces portraits : « Transport en commun », « Fluorence », « Fléopard », « Confiance », « L’œuvre muette », « Gothique moderne », « Zbigniew », « Grand Père Lucéram ». Il n’y a pas un style. Mais un agglutinement de manières : une polygraphie incarnée dans la chair de la peinture. Flou, coulure, empâtement, aplat, dilution, réserve, non-fini, précision, densité. Voyage d’une polarité à une autre, et souvent au sein d’une même œuvre.
Catalyseur, c’est le corps d’Axel, sa main, qui est réceptacle de cette multiplicité. Réceptacle donc, et des empreintes picturales qu’il a regardées et assimilées à travers les œuvres qui l’ont nourri, et des relations interpersonnelles qu’il a nouées avec ses modèles. La manière dont Axel peint est la manière dont il vit. Voyage d’une polarité à une autre, de l’amour à la douleur, du doute à la confiance, de la présence à l’absence. Ce n’est bien sûr pas un hasard, qu’à ce moment précis de son cheminement, que là, aux côtés de cette peinture de portraits, Axel expose un nombre important d’autoportraits. Chose nouvelle dans son travail. On retrouve la figure de l’artiste dans « Confession », « Autoportrait », et aussi dans de grandes compositions, comme « Communion des Saints » ou « Écologie de l’Histoire ».
Nés à nouveau de diverses manières, médiums et outils. Ces autoportraits sont clowns, gilets jaunes. Ils sont Axel et ils sont Gréco, Rembrandt, Friedrich, Manet. Ils sont assis, face à, ou cloués au sol. Au carrefour de l’Histoire, de la petite et de la grande. Au carrefour de la tristesse et de l’amour, du sacré et de la trivialité. Nécessité de revenir à soi quand on perd pied, comme pour retrouver des racines, ces autoportraits sont un socle et révèlent tout ce qui fait la porosité de la peinture d’Axel. Il y a, dans l’intensité de leur regard qui vous habite, quelque chose d’interloqué. Une expression qui semble à la fois élever et enraciner votre corps, entre ciel et terre.
Il y a cet autoportrait : « Confession ». Où l’on voit la figure de l’artiste, assis au milieu de ses peintures. Une pensée surgit de sa tête, comme dans une bulle de bande dessinée : « Je n’ai jamais pu trouver mon langage en peinture, alors j’ai copié un style qui n’existe pas ». Un style qui n’existe pas. Si ce n’est dans les imbroglios d’un chef-d’œuvre inconnu. Un style qui vit bel et bien sur la toile. Et à l’intérieur de nous. La vie ? La peinture ? C’est une tentative impossible. Accueillir, dans le corps d’une image fixe, le tremblement d’un mouvement perpétuel. Entre le corps et l’âme, entre ce que l’on ressent et ce que l’on voit, entre le monde et soi.
Concrète mystique, socle vacillant, magma poreux : la peinture d’Axel s’ouvre en nous telle une myriade libre et amoureuse.
Amélie ADAMO, Paris, juillet-novembre 2021.