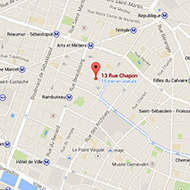Corps brisés
Ici, sur un rectangle d’un rouge irrégulier, se détache une main, figure de proue quasi immobile d’un avant-bras abandonné. Entre ombre et lumière, de ses cinq doigts solitaires, elle apostrophe celui qui passe, l’incitant à entrer. Là, un buste éreinté est en proie à des mouvements contraires. À la fois de chair et d’airain, des épaules fragiles redoublent d’efforts pour ne pas s’affaisser, tandis qu’un visage assoupi se laisse glisser vers un néant de lumière. Plus loin, des jambes s’agitent, vaine tentative d’échapper à l’attraction des couleurs sans fond qui les enserrent… À quel voyage ces corps fragmentés de Martin Bruneau sont-ils l’invitation ?
En fait de voyage, il s’agit d’un périple, c’est-à-dire d’un de ces longs voyages en mer dans lesquels les explorateurs, de la fin du XVe au début du XXe siècle, s’embarquaient à leurs risques et périls. De l’aveu-même du peintre, cette nouvelle série trouve son origine dans le célèbre tableau de Géricault, le Radeau de la Méduse (1819). Il y a donc fort à parier que la traversée ne sera pas de tout repos. En 1816, la Méduse, un navire français, avait échoué sur un banc de sable, au large du Sénégal. Une partie des passagers était alors montée dans les chaloupes, les autres, par manque de place, avaient été obligés de se réfugier sur un radeau de fortune. La suite de l’histoire importe peu puisque le tableau de Géricault n’est, ici, que le point de départ à partir duquel Bruneau déploie son talent. Ainsi, le radeau construit par les naufragés de la Méduse est pour ainsi dire absent. Demeurent les corps dont Bruneau a conservé la position et les mouvements qui étaient les leurs sur le frêle esquif. Ils semblent flotter, entre ciel et mer, vie et mort, alarme et repos. Surtout, l’artiste s’est plu à les séparer, à les fragmenter, à les amputer. C’est sans doute la raison pour laquelle ils apparaissent comme brisés sur les récifs du radeau disparu.
Reliés les uns aux autres, les corps de Bruneau décrivent une danse macabre qui se déploie telle une métaphore de la peinture qui, entre figuration et abstraction, a encore et toujours quelque chose à dire. C’est là le tour de force du peintre d’être parvenu à composer une variation sur le corps, où les couleurs, implacables contrepoints, donnent le tempo, jusqu’à parfois laisser croire qu’elles mènent la danse. Sa palette peut donc laisser libre cours à la force de la couleur et se déployer pour dire non pas tant autre chose qu’autrement. Ainsi sublimée, la couleur de Bruneau ne saurait se réduire à un simple aplat ou à un fond sommaire. Elle s’ingénie à neutraliser, à tout le moins à contrarier, la dimension narrative de la toile. En somme Bruneau opère, là, un de ces renversements chers à Baselitz qui aimait à dire que « le renversement (...) du motif [lui] donnait la liberté de [s’]attacher à des problèmes picturaux. » Non seulement Bruneau soulève des problèmes, mais il s’attache à les résoudre. Sous son pinceau, la juxtaposition de deux peintures – abstraite et figurative – ne jure pas. Au contraire elle s’équilibre au-delà des corps et de la couleur, selon des lois relevant de la (méta)physique de la peinture et menant à cette « pureté de la peinture » si chère au critique Clement Greenberg. La possibilité d’une représentation demeure, malgré tout – et non pas en vain. C’est sur cette voie que Bruneau a choisi de naviguer.
Guillaume PICON, 2014
Historien et commissaire d’exposition